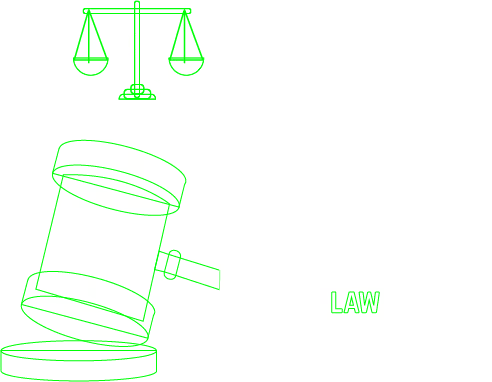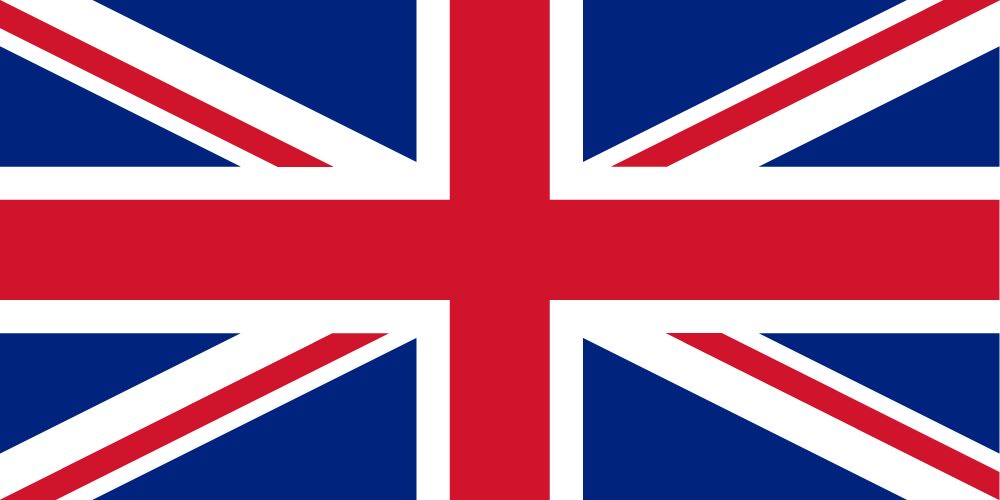Pourquoi Nous
À propos de nous
Qui nous sommes
Ils parlent de nous
Découvrez ce que d'autres pensent de notre impact dans l'industrie
Chroniques du carbone
Restez informé et inspiré avec nos articles provoquant qui suscitent la réflexion
Date 4 Climat
Une initiative ECONOS pour la base de données locale
Services
Introduction à l'empreinte carbone
Comprendre les émissions de scope 1, 2 et 3
Analyse de l'empreinte carbone
Découvrez les étapes pour calculer vos émissions de CO2
LCA
Découvrez l’impact environnemental de vos produits et services à travers l'Analyse du Cycle de Vie
Réduire l'Empreinte Carbone
Découvrez des recommandations personnalisées pour minimiser votre Empreinte Carbone
Notre plateforme
Automatiser le calcul de l'empreinte carbone à l'aide du logiciel ECONOS
Conformité à la législation de l'UE
Découvrez quelles sont vos obligations en vertu du droit de l'UE
Rapport ESG
Élevez vos normes de divulgation et communiquez votre engagement envers les principes ESG
Certification EcoVadis
Obtenez rapidement la certification EcoVadis avec ECONOS
Reporting CDP
Nous améliorons le reporting CDP de votre entreprise - du calcul complet des émissions carbone à la rédaction de réponses CDP de haute qualité pouvant vous conduire à un score CDP Leadership
CBAM
Anticipez les évolutions réglementaires et découvrez les obligations des importateurs et fournisseurs
Taxonomie de l'UE
Critères, mise en œuvre et aspects de reporting de la taxonomie de l'UE
Fresque climatique
Comprendre les aspects essentiels du changement climatique et ses implications dans un contexte professionnel et individuel
Développement durable 101
Comprendre les fondamentaux du développement durable
Naviguer à travers l’ESG
Équipez-vous des outils nécessaires pour mettre en œuvre l’ESG au sein de votre stratégie commerciale
Pacte vert pour l’UE
Positionnez votre entreprise pour contribuer aux objectifs du Green Deal de l’UE